A Vézelay, sur un des quatre piliers du transept de la basilique, des marques de tailleurs de pierre : certaines, comme d’habitude, sont des initiales ou des monogrammes combinant harmonieusement une ou deux lettres. D’autres, en revanche, plus rares, comme des apparitions merveilleuses surgies de la pierre, sont déjà des représentations stylisées d’une réalité : feuille, fleur… J’aime à penser que ces artisans qui osent ne plus signer de leurs seules initiales et font un chemin vers la représentation sont ceux qui, à un moment ou à un autre, deviendront artistes, sculpteurs de chapiteaux.

L’observation de ces marques rappellent les premiers graveurs sur bois ou sur cuivre, qui, trois ou quatre siècles plus tard, signent ainsi leurs oeuvres. Ainsi le maître lyonnais JG - qui travaille vers 1530-1550 - longtemps resté sans nom patronymique, mais que les historiens modernes ont identifié avec une certain Jacques Germain, recensé comme orfèvre. De même, Dürer bien que premier à signer de son nom une oeuvre peinte, L’autoportrait à la fourrure, en 1500, a plus fréquemment utilisé son monogramme, ce A dont les jambages encadrent le D.
Autre rapprochement, onomastique celui-là : les tailleurs de pierres ont leur équivalent pour le papier, les « tailleurs d’images » : c’est ainsi qu’on appelle, de préférence à d’autres dénominations, à la fin du XVème et au XVIème les artisans graveurs sur bois ou cuivre, qui traduisent dans le matériau le dessin de l’artiste. Et parfois les artistes eux-mêmes se nomment ainsi, par exemple Georges Reverdy, autre grand graveur lyonnais, selon les archives du temps. Les artistes graveurs du XVème ou XVIème siècle sont proches encore, par l’apprentissage de ces savoir-faire, des artisans.
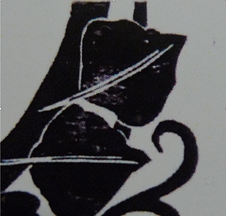
Ces rapprochements entre artisans de la pierre ou du bois rappellent donc ce lieu commun historique selon lequel l’artisan s’élève, plus tardivement d’ailleurs en France qu’ailleurs vers le statut plus noble d’artiste. Et curieusement, ce court voyage dans le Moyen-Age sculpté des tympans et chapiteaux bourguignons, et cette représentation d’une feuille en particulier, fait écho au présent : par exemple à cette autre feuille, détail d’une estampe gravée sur bois tout à fait récente de Pierrette Burtin-Serraille.
Bien sûr, il s’agit d’une estampe vue dans une exposition intitulée Du pariétal au médiéval ( exposition de groupe, celle de l’Empreinte, bientôt visible au Musée de l’Imprimerie de Lyon). Il n’est pas donc extraordinaire que nombre de ces estampes se nourrissent de l’imaginaire médiéval et de ses formes.
Cela pose la question de savoir pourquoi des graveurs contemporains ont éprouvé le désir d’inscrire leur travail dans cette thématique historique. Pour justifier cette contrainte on peut avancer la mode, bien sûr, ( l’ouverture de la grotte Chauvet 2 a fait couler beaucoup d’encre), mais aussi le besoin de la commémoration ou de l’hommage, le désir de rendre visible la permanence historique du geste du graveur depuis le XVème siècle, de donner de la profondeur ou du sens à son travail, ou encore de retrouver les moyens d’un art qui touche à l’universel.
Cela assure peut-être ainsi qu’aujourd’hui comme hier l’art le plus évident est fait de simplification, de retranchement. Et nul doute que la taille dans le bois, par essence même, facilite ce principe.
On voudrait croire, in fine, que tous les artistes contemporains, bien que savantissimes, accordent un intérêt, non pas aux leçons du passé car il ne s’agit pas de cela, mais plus simplement à sa présence.
« Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer. C'est ce que j'ai toujours fait » a dit un jour Louise Bourgeois, qu’on ne peut guère suspecter de ringardise.
P.B.

Écrire commentaire